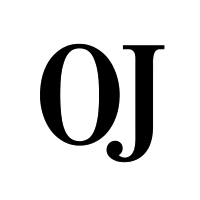Que sait-on vraiment de l’économie chinoise ?
“Man-made” : c’est ainsi que l’ancien premier ministre chinois, Li Keqiang, aurait qualifié les données économiques de la Chine lors d’un entretien confidentiel avec l’ambassadeur américain Clark Randt en 2007, révélé dans le cadre des Wikileaks. La manipulation par la Chine de ses rapports économiques serait donc un secret de polichinelle dans le cercle fermé […]

“Man-made” : c’est ainsi que l’ancien premier ministre chinois, Li Keqiang, aurait qualifié les données économiques de la Chine lors d’un entretien confidentiel avec l’ambassadeur américain Clark Randt en 2007, révélé dans le cadre des Wikileaks. La manipulation par la Chine de ses rapports économiques serait donc un secret de polichinelle dans le cercle fermé des hauts diplomates. Partout pourtant les images semblent nous prouver que le miracle économique chinois est bel et bien réel. Les médias se font régulièrement l’écho des grands succès chinois : avance stratégique dans le domaine de la 5G, essor des fabricants automobiles chinois sur le marché européen, apparition aussi soudaine qu’inattendue de géants chinois dans chaque secteur de l’économie, dont le dernier exemple est DeepSeek, dont l’essor a fait chuter soudainement la capitalisation boursière des géants américains des technologies fin janvier 2025. Pourrait-on vraiment rejeter ces constats ? Doit-on conclure que nos considérations sur l’économie chinoise depuis plusieurs années doivent être remises en question ? Loin de rejeter sans concession les acquis économiques et sociaux de la République Populaire de Chine depuis le tournant des années 70, cet article entend adopter un regard critique sur ce que nous pensons savoir de la situation économique de l’Empire du milieu.
Des données statistiques étroitement supervisées par le parti unique
Alors que plusieurs pays européens encaissaient par vagues successives la recrudescence des cas de Covid-19 entre 2020 et 2021, les autorités chinoises s’étaient très tôt félicitées d’avoir surmonté “l’épreuve du Covid-19”. Statistiques à l’appui, le PCC affirmait être parvenu à enrayer la propagation du Coronavirus grâce à une politique “zéro-Covid” dont le succès prétendument fulgurant contrastait largement avec les images d’une Amérique au système de santé défaillant submergée par la contagiosité du Covid-19. Premier pays concerné par la crise sanitaire, la Chine communiste prétendait fièrement être également la première grande économie à en être sortie. Dès 2022, la réalité avait rattrapé les déclarations du parti unique, forçant les autorités à désavouer leur politique “zéro-Covid”. Entre-temps, les données sanitaires chinoises avaient perdu toute continuité logique adoptant des trajectoires discontinues et erratiques. La crise sanitaire, par sa large couverture médiatique avait alors offert le spectacle ahurissant de l’absurdité de certaines données officielles chinoises, montrant également par la même occasion que ces dernières avaient fonction de propagande interne et externe. Très tôt en 2020 et en 2021, des voix s’étaient déjà élevées pour dénoncer des fake news d’Etat quant à la crise sanitaire. Alors que Xi Jinping approchait la fin de son mandat, face à l’accumulation des déboires politiques à Hong-Kong, au Xinjiang et auprès de la jeunesse, et dans la perspective d’une compétition engagée avec les Etats-Unis sur tous les fronts, le pouvoir chinois ne pouvait se permettre tel aveu de faiblesse. Il en va de même pour les données économiques du pays. La bonne santé économique du pays sert de caution au prestige et à la légitimité du pouvoir en place. Méfiance, donc, à l’égard des données officielles chinoises, lesquelles sont régulièrement dénoncées par les observateurs internationaux pour leur méthodologie opaque et leur manque de vérifiabilité.
Entre ignorance et corruption : La méconnaissance même du PCC de sa propre économie
Comme nous l’avons vu, la Chine est soupçonnée de délibérément fausser ses données économiques. Cela laisserait croire qu’est précieusement détenu à Pékin le secret des véritables chiffres sur la santé économique du pays. La réalité est toute autre : il est en fait probable que le PCC soit le premier à ignorer la mesure réelle de sa propre économie. En 2012 déjà, un scandale éclatait au sein des instances fédérales chinoises : Le Bureau National des Statistiques (BNS) accablait dans un rapport interne des chiffres “sérieusement faux” dans une province industrielle voisine de Pékin, le Shanxi. En cause, des dignitaires locaux du Parti Communiste ayant décidé d’embellir leur bilan économique à des fins carriéristes. Que les provinces autonomes déclarent un PIB aggloméré supérieur par plus de 500 milliards de dollars au PIB national officiellement communiqué par Pékin cette année-là posait un véritable problème de crédibilité aux autorités fédérales, que ce soit d’un point de vue de la politique extérieure, ou auprès des investisseurs étrangers. L’incapacité de Pékin à mesurer sa propre économie de façon fiable a été prise très au sérieux, en particulier depuis la présidence de Xi Jinping, marquée par une période d’épuration en interne et de lutte contre la corruption des hauts dignitaires du Parti.
Des limites méthodologiques
En dehors des considérations sur l’impartialité des rapports économiques publiés par la Chine et sur ses problèmes de corruption, force est de constater que le cadre même du marché intérieur chinois engendre des difficultés méthodologiques, lesquelles viennent complexifier les analyses macroéconomiques de la situation du pays. Revenons-en à la discussion entre Li Keqiang et Clark Randt. Au cours de ce même échange, Li Keqiang aurait expliqué à son homologue américain que pour prendre la température de la croissance économique du pays, et surveiller la santé de l’industrie chinoise, les autorités prenaient en compte 3 indicateurs clé: la consommation électrique des provinces, le volume du fret ferroviaire, et le nombre d’emprunts accordés par les banques. De l’aveu même de l’ancien premier, le produit intérieur brut (PIB) n’était pour la Chine un indicateur ni fiable ni pertinent. De façon plus générale, ce sont les indicateurs monétaires qui ne semblent que peu correspondre au cadre de l’économie chinoise, ne reflétant donc pas de façon satisfaisante la réalité économique du pays. En cause, l’hétérogénéité de l’économie chinoise. En reprenant les chiffres statistiques du BNS, on constate un rapport de 9 pour 1 entre le PIB par habitant de la province la plus riche du pays (Shanghai), et celle la plus pauvre (Guizhou). De telles inégalités de revenu et de développement poussent à questionner la pertinence des indicateurs de PIB ou de PIB par habitant, qui ne sont que des mesures de la richesse agglomérée ou moyenne d’un pays. Par ailleurs, dans les provinces rurales du pays, une partie non négligeable de l’économie procède de façon non-monétaire, ou bien échappe au contrôle des administrations fiscales. C’est le cas de façon significative de l’économie souterraine, ou des usines de travail forcé dans les régions reculées de l’Ouest chinois. Ce sont des secteurs entiers de l’économie du pays qui se retrouvent ainsi par nature sous-estimés. In fine, les outils de mesures traditionnels utilisés par les observateurs internationaux pour analyser et quantifier une économie donnée se heurtent à la réalité du marché intérieur chinois. A la façon de Li Keqiang, il est donc pertinent de repenser les méthodologies usuelles en matière d’analyse macroéconomique et géoéconomique lorsqu’il s’agit de certains pays comme la Chine. Le journal The Economist avait déjà créée en 1986 le “Big Mac Index” pour mesurer la parité de pouvoir d’achat (PPA) de chaque pays grâce au référentiel global du prix d’un Big Mac américain. En 2010, le journal avait réitéré en élaborant le “Li Keqiang Index”, indice économique basé sur les propos du haut dignitaire éponyme évoqué en introduction reprenant les enseignements de ce dernier pour mesurer la croissance économique chinoise en analysant la consommation électrique des provinces, le volume du fret ferroviaire, et le nombre d’emprunts accordés par les banques. Ce même indice a régulièrement permis aux investisseurs et aux observateurs internationaux de nuancer les données économiques communiquées par les autorités chinoises.
Que vaut vraiment l’économie chinoise ?
Le « derisking » (réduction des risques) est une stratégie adoptée par plusieurs pays et entreprises pour réduire leur dépendance économique à la Chine, notamment face aux tensions géopolitiques et aux incertitudes économiques. le ravivement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis avait relancé une vague de “derisking” en 2023. Mais dès la fin de l’année 2021, autre vague de “derisking” avait été engagée par les investisseurs contre l’économie chinoise. En ce qui concerne cette dernière, ce n’étaient pas des considérations géopolitiques qui faisaient craindre un risque sur les investissements en Chine, mais plutôt des doutes sur les fragilités structurelles de l’économie de l’Empire du milieu, dont le secteur de l’immobilier représenterait jusqu’à 30% du PIB. En décembre 2021 déjà, Fitch Ratings avait dégradé la note du promoteur immobilier Evergrande, le classant comme “en défaut de paiement”. Depuis, les doutes sur la solidité et la résilience du marché intérieur chinois planent sur les places financières du pays. La dépendance de l’économie chinoise à son secteur de l’immobilier, et la dépendance de ce même secteur à des investissements publics étaient apparues au grand jour dans les années suivantes, en même temps que la trajectoire du PIB chinois adoptait une trajectoire concave, signe de l’entrée dans une période de ralentissement durable de l’économie chinoise. Les perspectives de l’économie chinoise se donc sont considérablement assombries dans les dernières années. Longtemps sujet à spéculation, la date à laquelle l’économie chinoise devrait dépasser celle des Etats-Unis n’a eu de cesse de reculer depuis le début des années, si bien qu’il est désormais remis en doute que la Chine ne détrône un jour les Etats-Unis.
Conclusion
On a souvent pensé pouvoir prédire ce qu’il adviendrait de la Chine et de son économie. Objet de fantasmes, de spéculation financière, et de tensions géopolitiques, la santé économique de la deuxième puissance économique mondiale continue à faire débat. Il reste donc difficile de trancher sur la question du potentiel et de l’état actuel de cette économie, qui continue à échapper à nos prévisions et à certains de nos outils de mesure. Si les observateurs internationaux et les investisseurs ont des raisons de douter des perspectives économiques et de développement de ce pays dans un contexte de ralentissement démographique, de saturation de la demande, et de tensions commerciales avec les Etats-Unis, la Chine continue de profiter de solides atouts, parmi lesquels la profondeur de son marché intérieur, la richesse de ses sols en terme de terres rares, son avance dans les domaines stratégiques de la 5G, son potentiel en matière d’IA incarné par le succès récent de DeepSeek, et le potentiel que pourraient délivrer les nouvelles routes de la soie dans les années à venir.
Matthias Duguey