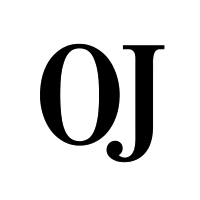Papa l’Americano : Léon XIV et la géopolitique du Saint-Siège
Le jeudi 8 mai, le 267ème pape de l’Église catholique, Léon XIV, a été élu au terme d’un conclave de 2 jours. Les 133 cardinaux électeurs ont choisi Robert Francis Prevost, un cardinal originaire de Chicago aux Etats-Unis. S’il est américain, le cardinal Prevost est perçu comme un homme d’Église « qui dépasse les frontières » d’après […]

Le jeudi 8 mai, le 267ème pape de l’Église catholique, Léon XIV, a été élu au terme d’un conclave de 2 jours. Les 133 cardinaux électeurs ont choisi Robert Francis Prevost, un cardinal originaire de Chicago aux Etats-Unis. S’il est américain, le cardinal Prevost est perçu comme un homme d’Église « qui dépasse les frontières » d’après le New York Times, puisqu’il a servi au Pérou pendant plus de vingt ans et y a acquis la nationalité. Cette élection semble aller à l’encontre de l’idée qu’il ne fallait pas désigner un pape issu d’une grande puissance mondiale qui a déjà une grande influence sur le monde. Surtout que le pape est le seul chef religieux à être aussi chef politique.
Léon XIV, qui semble être dans la ligne droite de son prédécesseur notamment en raison de sa vision progressiste et de son combat contre la pauvreté, va avoir un grand rôle à jouer au sein de notre époque troublée. En effet, les bouleversements contemporains ne sont pas sans rappeler les tensions entre progrès et traditions qui ont marqué le XIXᵉ siècle. Les sociétés humaines traversent une période d’effervescence marquée par des reconfigurations profondes des rapports de force, tandis que la transition technologique, porteuse de bouleversements majeurs, suscite à la fois espoirs et résistances. Cette mission politique au sein du Saint Siège apparaît surtout à partir du pape Léon XIII (1878-1903). Le souverain pontife a exercé son ministère à une époque secouée par de profonds bouleversements notamment la sécularisation de la société et l’industrialisation galopante. Mais c’est surtout à partir de la création de l’État du Saint-Siège en 1929, que le pape va commencer à jouer un rôle sur la scène internationale.
Le Saint-Siège est l’héritier d’une histoire qui remonte au VIIIème siècle. A cette époque, le successeur de Pierre contrôle le tier central de l’Italie : on parle des États pontificaux. En 1870, ces territoires sont annexés au Royaume d’Italie. Il faut alors attendre 1929 et les accords de Latran pour que l’Italie reconnaisse la souveraineté du Saint-Siège sur un territoire indépendant : la Cité du Vatican, un État de 44 hectares situé au cœur de Rome. Dirigée par le pape, cette théocratie exerce une influence spirituelle sur près d’1,4 milliard de catholiques à travers le monde. Cette influence s’étend aussi via la diplomatie puisque le Saint-Siège est membre et observateur de plusieurs organisations internationales dont l’ONU et est représenté dans 183 pays. Cet État reste toutefois ambigu puisqu’il n’a pas d’armée (seulement 110 gardes suisses assurent sa protection), de monnaie, d’industrie et n’est pas reconnu comme un membre complet de l’ONU. Il est important de différencier l’État du Saint-Siège, qui est une entité juridique et souveraine qui représente l’autorité spirituelle et gouvernementale de l’Église catholique dans le monde, de la cité du Vatican, qui est un État territorial situé à l’intérieur de la ville de Rome : c’est pour cela que le Saint-Siège peut subsister même si son territoire, le Vatican, est envahi.
Grâce à ces nombreuses relations diplomatiques, le Saint-Siège utilise son soft Power pour sa cause (gagner des fidèles notamment en Afrique et en Amérique du Sud) mais aussi celle des autres, son but : devenir un médiateur incontournable sur la scène internationale. Le pape s’appuie ainsi sur une conception multilatérale puisque le Saint-Siège se veut neutre. Dans certains pays, il bénéficie d’un statut particulier en étant reconnu comme le doyen du corps diplomatique, ce qui renforce son autorité morale et politique dans les relations internationales. Cette position singulière lui permet d’agir comme un interlocuteur crédible dans la résolution de conflits. Par exemple, en 2015, le blocus imposé par les États-Unis sur Cuba depuis 1962 a été levé un temps (Donald Trump lors de son premier mandat rejettera ces accords et refermera l’ambassade) grâce à l’intervention diplomatique discrète du Saint-Siège. Le Saint-Siège mobilise ainsi une influence douce fondée sur des valeurs universelles telles que la paix, la dignité humaine ou le dialogue interreligieux, ce qui renforce sa légitimité sur la scène internationale. Sa voix morale, relayée par le pape et un vaste réseau d’institutions catholiques à travers le monde, lui permet de peser dans les débats mondiaux, notamment sur les questions migratoires, climatiques ou humanitaires. Le pape François, en particulier, a défendu avec force l’accueil des migrants et a alerté la communauté internationale sur l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique, notamment à travers son encyclique Laudato si’.
Oscar Pierart