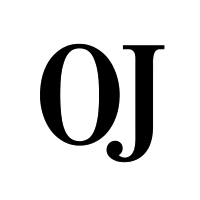La mise en place d’une défense européenne : effet d’annonce ou réalisation concrète ?
Depuis quelques mois, l’incertitude liée à la réélection du président américain Donald Trump a fait s’interroger les pays européens sur les questions que posent la dépendance à l’industrie militaire des Etats-Unis, le président américain ayant menacé ses derniers mois le Groenland, le Canada et le Panama notamment. En torpillant l’OTAN et ses Etats membres, qui […]

Depuis quelques mois, l’incertitude liée à la réélection du président américain Donald Trump a fait s’interroger les pays européens sur les questions que posent la dépendance à l’industrie militaire des Etats-Unis, le président américain ayant menacé ses derniers mois le Groenland, le Canada et le Panama notamment. En torpillant l’OTAN et ses Etats membres, qui n’ont d’ailleurs pas échappé aux droits de douane que Donald Trump applique au monde entier, certains pays ont vu vaciller la doctrine sur laquelle ils s’étaient appuyés depuis la fin de la Guerre Froide, en perdant progressivement la jouissance de « dividendes de la paix ».
Face à cette situation, l’Union Européenne a montré, à travers les discours politiques, une certaine volonté de développer sa BITD (base industrielle et technologique de défense). Le 4 mars 2025, Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé un plan massif annonçant le désir d’investir 800 milliards dans le secteur de la défense d’ici 2030. La progression immense des cours de bourse des principales entreprises européennes du secteur, comme Dassault Aviation ou Thalès (France), Rheinmetall (Allemagne) ou encore Leonardo (Italie) témoigne également des attentes de nombreux citoyens et de la signature de nombreux contrats pour les entreprises.

L’Union européenne possède de nombreux avantages dans ce secteur. Dans le top 5 des pays exportant le plus d’armes dans le monde, deux se situent dans l’UE, à savoir la France (deuxième place du classement, 10,9% des exportations totales) et l’Allemagne (à la 5ème position, 5,6% des parts de marché). Ces entreprises disposent d’un vrai savoir-faire, sur l’ensemble des véhicules militaires existants (avions de chasse, chars, missiles).
Ce réarmement possède un double avantage pour l’Europe. D’une part, il permet une réindustrialisation, avec la création d’un nombre significatif d’emplois qualifiés (environ 600 000 personnes travaillant dans ce domaine en Europe, dont 210 000 pour la France). De plus, celui-ci permettrait le retour d’une souveraineté sur un domaine stratégique, et permettrait d’affirmer le poids de l’UE à l’échelle internationale. En effet, acheter du matériel américain revient à être soumis à l’extra-territorialité du droit de la 1ère puissance mondiale, les Etats-Unis disposant de la politique ITAR (International Traffic in Arms Regulation), qui désigne l’ensemble des règlements du gouvernement fédéral américain servant à contrôler les importations et exportations des objets et services liés à la défense nationale.
Cette tendance semble être sur une pente ascendante, les mesures politiques en faveur d’une réindustrialisation se multipliant. Entre 2021 et 2024, les dépenses des Etats membres de l’UE ont augmenté de 30%, pour atteindre 326 milliards de $ en 2024. En Allemagne, les députés ont également ouvert la voie le 18 mars une proposition réformant la capacité de l’État à s’endetter (la Constitution allemande limitait en effet le déficit à hauteur de 0,35%), afin d’augmenter leurs investissements dans leur défense nationale. Cette mesure, impensable il y a quelques mois tant le frein à la dette est ancré dans la mentalité des citoyens, témoigne des craintes des pays européens face aux incertitudes géopolitiques.
Cependant, de nombreuses difficultés viennent affaiblir ce volontarisme politique
Malgré les discours, de nombreuses incertitudes persistent concernant la création d’une réelle BITD européenne.
Il s’agit tout d’abord du fait que la dépendance aux Etats-Unis, dont la mainmise sur l’Europe a été quasi-totale depuis 50 ans, n’est pas prête de disparaître. Les Etats-Unis représentent en effet 41,7% de la valeur totale des exportations d’armes dans le monde, et dominent donc très largement le classement. De plus, ces dernières années, les Etats membres de l’UE se sont principalement fournis auprès d’acteurs extérieurs, à hauteur de 80% des achats d’équipements, dont 60% pour les Etats-Unis seuls. Les contrats industriels s’inscrivant sur un temps long, il faudra des années pour que les contrats déjà signés deviennent obsolètes.

De nombreux pays européens sont également réticents à l’idée d’acheter de l’équipement produit sur le continent, surtout pour les Etats les plus atlantistes. Sur ce sujet, la France s’est toujours retrouvée relativement seule, prônant une souveraineté européenne, dont l’origine trouve ses racines dans l’héritage du général de Gaulle, qui s’est toujours méfié de l’hégémonie américaine. Pour d’autres pays, comme le Royaume-Uni ou les Etats baltes, l’achat de matériel américain a toujours également été le moyen de s’attirer les faveurs des Etats-Unis, pour s’assurer qu’ils appliqueront bien l’article 5 de l’OTAN en cas de guerre (principe de défense mutuelle si un Etat membre est attaqué). Si les frasques de Donald Trump entraînent de vives oppositions de la part des Etats européens, comme au Danemark, pays pourtant très atlantiste mais dont la souveraineté est menacée par les déclarations de Donald Trump disant vouloir annexer le Groenland, il n’en reste pas moins que la conception d’une défense commune demeure un spectre lointain.
De plus, malgré un certain nombre de programmes militaires communs au sein de l’Union Européenne (comme le partenariat franco-italien ayant permis la création des frégates multi-missions, ou FREMM), il n’en résulte pas moins que l’imbrication des filières demeure limitée à l’échelle de l’UE. Chaque pays souhaitant défendre au mieux ses intérêts, en ne partageant pas ses secrets industriels, les projets communs demeurent réduits. Le SCAF, par exemple, le système de combat aérien du futur (avion de chasse de nouvelle génération), a par exemple vu ses délais allongés en raison de difficiles négociations entre les Etats concernés (France, Allemagne, Espagne).
Enfin, l’aspect financier en lui-même interroge. De nombreux Etats comme la France souffrent en effet d’une dette nationale qui ne cesse d’augmenter. A ce titre, débloquer 800 milliards en 5 ans à l’échelle de l’UE peut être perçu comme un objectif irréalisable. De plus, ces investissements se heurtent aux contestations d’une certaine partie de la population, qui défendent une répartition différente de ces fonds vers d’autres domaines eux aussi indispensables comme l’éducation ou la santé.
Conclusion
Pour conclure, avec la guerre en Ukraine et les incertitudes géopolitiques liées au retour de Donald Trump à la Maison Blanche, l’Union Européenne tente de renforcer sa souveraineté militaire, afin de réduire sa dépendance aux Etats-Unis, qui ne sont plus toujours perçus comme un allié fiable. Néanmoins, si l’Europe dispose de nombreux atouts en la matière, les contraintes financières et les tractations difficiles entre les Etats membres limiteront ce volontarisme politique. Face aux menaces de plus en plus persistantes des acteurs extérieurs, celle-ci devra se réformer pour s’affirmer sur la scène internationale, ou bien devenir progressivement dans le futur un acteur de second plan, notamment sur le plan militaire.
Aymeric Lefebvre