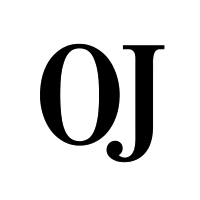Eloge des micro-sociétés : une alternative idéaliste au projet de gouvernance mondiale
L’hypothèse que nous explorons ici est que la cohésion sociale et la paix pourraient résider non dans une centralisation toujours plus grande, mais dans un retour à des structures de taille humaine : les micro-sociétés.

Depuis les débuts de l’histoire humaine, les structures sociales ont connu un processus d’agrégation croissante. Des clans préhistoriques aux empires antiques, jusqu’aux États-nations modernes, l’humanité semble s’être constamment dirigée vers des entités toujours plus vastes et centralisées. Si cette dynamique a permis certains progrès, elle soulève aujourd’hui des interrogations quant à ses limites humaines, sociales et politiques. L’hypothèse que nous explorons ici est que la cohésion sociale et la paix pourraient résider non dans une centralisation toujours plus grande, mais dans un retour à des structures de taille humaine : les micro-sociétés.
L’agrégation des structures sociales : un schéma historique ancien
L’historien Arnold J. Toynbee, dans A Study of History, identifie un modèle récurrent d’émergence, de croissance et de déclin des civilisations. Il insiste sur le fait que les civilisations se développent par leur capacité à répondre à des défis, mais qu’elles tendent à se rigidifier en structures monolithiques lorsqu’elles atteignent un haut degré de centralisation. Cette rigidité, selon lui, les rend vulnérables au déclin.
Ce processus est visible à travers les grandes étapes de l’histoire : les tribus nomades deviennent villages, puis cités-États (Uruk, Ur, Sumer ou encore Athènes), ensuite des empires (Rome, Chine impériale), puis des États-nations (France, Allemagne). Chaque étape est motivée par des impératifs de protection, de commerce, d’administration, mais aussi par une idéologie du progrès où la grandeur de l’entité est vue comme synonyme d’efficacité.
Benedict Anderson, dans Imagined Communities, montre comment les nations modernes sont des constructions symboliques fondées sur des récits partagés et des instruments comme l’imprimerie, la langue nationale ou l’histoire commune. Ces « communautés imaginées » rendent possible l’agrégation de millions d’individus, mais elles exigent une homogénéisation qui affaiblit les liens sociaux réels.
Limites cognitives et sociales des grandes structures
L’anthropologue Robin Dunbar, dans Grooming, Gossip, and the Evolution of Language, démontre que les humains ne peuvent entretenir des relations sociales stables qu’avec environ 150 personnes : c’est le fameux « nombre de Dunbar ». Au-delà, les relations deviennent abstraites, les individus ne se connaissent plus directement, ce qui nuit à la solidarité et à l’entraide.
Dans les grandes sociétés modernes, cette limite cognitive est constamment dépassée. La bureaucratie, les médias de masse et les institutions anonymisent et remplacent les relations humaines directes. Cela entraîne une perte de responsabilité individuelle, un sentiment d’impuissance citoyenne et une fragmentation sociale. Les micro-sociétés, à l’inverse, permettent de retrouver des liens organiques, une responsabilité mutuelle et une charité naturelle. C’est ce qu’avait déjà observé Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Lors de son voyage aux États-Unis, il note l’importance du tissu associatif et communal dans la vitalité de la démocratie américaine de cette époque. Selon lui, les citoyens se réunissent spontanément pour gérer les affaires locales, entretenir les routes, fonder des écoles, ou venir en aide aux plus démunis. Cette vie locale riche favorise un apprentissage quotidien de la responsabilité civique.
La paix par la décentralisation : micro-sociétés contre gouvernement mondial
Dans De l’esprit des lois, Montesquieu soutient que la forme d’un gouvernement doit s’adapter à la taille du territoire qu’il administre. Selon lui, la république ne peut s’épanouir que dans un petit État, car elle repose sur la vertu, c’est-à-dire le dévouement des citoyens au bien commun. Cette vertu suppose une participation active aux affaires publiques, ce qui est difficilement réalisable dans de grandes structures où les citoyens se trouvent éloignés du pouvoir. Les petites communautés, permettent aux citoyens de s’impliquer directement, de se connaître, et de maintenir cette vertu. Il ajoute que la taille d’un État influence la forme de son gouvernement. Ainsi, plus l’État est vaste, plus il a besoin d’une autorité centrale forte, au risque de tomber dans le despotisme.
Les micro-sociétés offrent une alternative pacifique à la tentation d’un gouvernement mondial. Ce dernier, bien qu’idéaliste dans ses intentions, pourrait sombrer dans un totalitarisme technocratique, étouffant les diversités culturelles et rendant la contestation impossible. Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, montre comment la centralisation absolue du pouvoir peut mener à la suppression de toute liberté.
Les petites sociétés, au contraire, n’ont pas les moyens matériels d’opprimer massivement, ni l’intérêt à l’expansion. Leur interdépendance économique et culturelle pourrait générer une paix durable par le besoin mutuel et la coopération. En cela, elles rejoignent la vision de Leopold Kohr, auteur de The Breakdown of Nations, qui plaidait pour des entités politiques de petite taille comme gages de liberté, de justice et de paix. Il énonçait ainsi : « partout où le processus d’union en vient à sa conclusion logique, la fertilité culturelle se flétrit ». Et au-delà de cet aspect culturel, « la petite unité, la cité indépendante grecque, où chacun connaissait celui qui arrivait, qui produisit des géants intellectuels tels que Thucydide et Aristophane, Héraclite et Parménide », peut être un catalyseur de grandes pensées.
Repenser les institutions
Adapter ce modèle aux États modernes exige une décentralisation progressive et ambitieuse. Il ne s’agit pas de fragmenter anarchiquement les pays, mais de renforcer l’autonomie locale dans un cadre régional. Le philosophe Pierre Rosanvallon, dans La société des égaux, rappelle que l’égalité véritable passe par une proximité dans la décision politique. Plus une décision est prise loin des citoyens, moins elle est perçue comme juste ou légitime. Il insiste sur la nécessité de « reconfigurer les modalités de la représentation démocratique » afin de mieux articuler la parole des citoyens aux institutions. Cela suppose de créer de nouvelles formes de participation qui permettent aux individus de se sentir écoutés et acteurs du bien commun.
Le sociologue David Graeber, dans La démocratie aux marges, s’appuie sur des cas ethnographiques pour montrer que de nombreuses sociétés non occidentales ou marginalisées mettent en place des formes d’organisation politique fondées sur le consensus, la collégialité et la délibération collective. Il réaffirme ainsi que la démocratie ne se résume pas aux formes électorales modernes mais peut émerger d’expériences locales concrètes, enracinées dans le quotidien. En ce sens, ces micro sociétés réinventent une forme de démocratie directe, où la participation active des citoyens ne se limite pas au vote, mais s’exerce au quotidien dans la délibération et la gestion collective.
Un modèle français de décentralisation pourrait permettre aux villes ou aux régions de collecter et de gérer directement une partie des impôts, allouant les ressources selon les priorités locales. Les services publics seraient ainsi plus adaptés, les citoyens plus impliqués, et la transparence accrue. Une telle réforme pourrait réconcilier l’efficacité administrative et la démocratie participative.
Pour clôturer ce propos, bien qu’utopique dans sa réalisation actuelle, le modèle des micro-sociétés pourrait offrir une réponse concrète aux crises de la modernité – i.e., crise de la représentation, crise sociale, crise environnementale. En s’appuyant sur les limites cognitives humaines et les enseignements de l’histoire, on peut imaginer un avenir où les structures politiques seraient plus proches, plus humaines, et donc plus justes. La véritable grandeur d’une société pourrait bien se mesurer à la taille de ses communautés humaines.