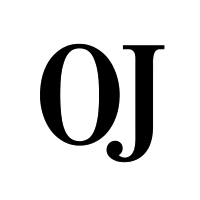Adam Smith, le philosophe et économiste aussi connu que méconnu
INTRODUCTION Adam Smith est connu tant pour ses travaux sur la rationalité des agents économiques que sur la division du travail avec son célèbre exemple de la fabrique d’épingles. Cependant, son mérite ne s’arrête pas là et s’étend à de nombreux autres domaines dans lesquels il a une importance encore trop peu saluée aujourd’hui. Cet […]
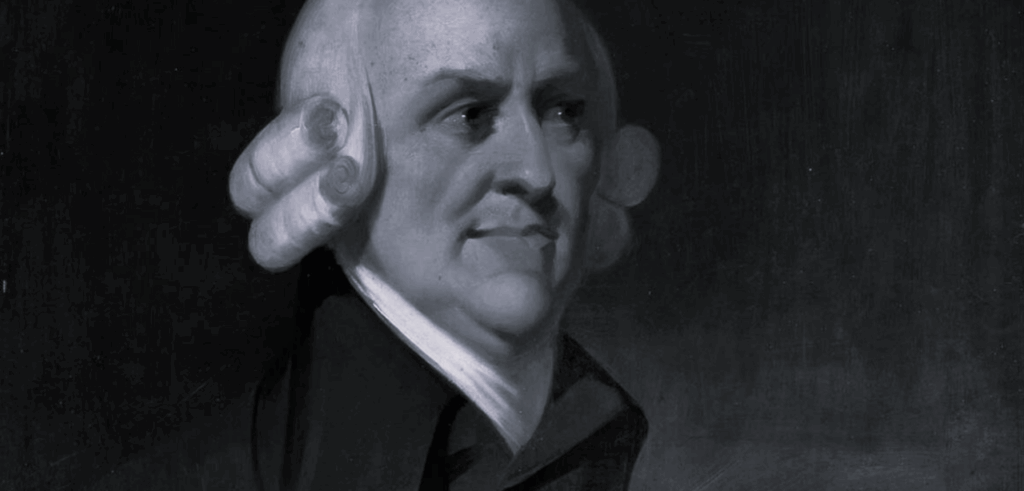
INTRODUCTION
Adam Smith est connu tant pour ses travaux sur la rationalité des agents économiques que sur la division du travail avec son célèbre exemple de la fabrique d’épingles. Cependant, son mérite ne s’arrête pas là et s’étend à de nombreux autres domaines dans lesquels il a une importance encore trop peu saluée aujourd’hui. Cet article se veut donc novateur en ce qu’il expose des perspectives d’Adam Smith souvent négligées ou peu explorées.
ADAM SMITH ET LA JUSTICE
Adam Smith soutenait la perspective comparatiste de la justice (1), qui évalue les modes de vie des populations en tenant compte des influences des institutions et des comportements individuels. Il illustrait cette approche en affirmant que l’abolition de l’esclavage rendrait le monde infiniment moins injuste, considérant que les sociétés sans esclavage sont clairement préférables à celles qui le pratiquent.
ADAM SMITH ET LE TRAVAIL
Adam Smith a également décrit les traits d’une nouvelle société :
« Une société bonne est une société qui permet au plus grand nombre de participer à la production et d’amener sur le marché la plus grande quantité possible de produits de manière à ce que l’opulence se répande jusqu’aux dernières classes du peuple.» (2)
Deux idées importantes se dégagent de cette citation (3) :
Premièrement, le plein-emploi pourrait se définir comme la situation dans laquelle toutes les personnes voulant participer à l’activité productive le peuvent sans contraintes.
Deuxièmement, la production doit permettre une redistribution des richesses produites à l’ensemble de la population.
ADAM SMITH ET L’INTÉRÊT PERSONNEL
ADAM SMITH ET L’INTÉRÊT PERSONNEL
On pense souvent à tort qu’Adam Smith défendait le postulat de la recherche exclusive de l’intérêt personnel. En effet, il a donné une analyse très fine des limites de cette hypothèse en soulignant que « l’amour de soi » (pulsion qui sous-tend le comportement intéressé) n’était que l’une des multiples motivations des êtres humains. Il distinguait plusieurs raisons d’aller à l’encontre des préceptes de l’amour de soi dont celles-ci :
L’empathie : « Les actions humaines ne consistent seulement qu’à agir comme cette exquise affinité nous pousse d’elle-même à le faire. »
La générosité : « Il en va autrement de la générosité, où nous sacrifions un grand et important intérêt à l’intérêt égal d’un ami ou d’un supérieur. »
Smith a longuement analysé la nécessité d’un comportement désintéressé et conclut : « Si la prudence est de toutes les vertus, la plus utile à l’individu, nous devons comprendre que l’humanité, la justice, la générosité et l’esprit public sont les qualités les plus utiles à autrui. » (4)
CONCLUSION
Si cet article permet de mettre en lumière d’autres travaux d’Adam Smith, nombreuses de ses idées attendent d’être plus encore travaillées. En effet, Adam Smith mérite plus de visibilité à propos de son mécanisme du « spectateur impartial » ou de sa vision du salaire de subsistance (5).
Bibliographie
1. L’idée de justice, Amartya Sen (2010)
2. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith (1776)
3. La mystique de la croissance, Dominique Méda (2013)
4. Théorie des sentiments moraux, Adam Smith (1759)
5. La garantie d’emploi :L’arme sociale du Green New Deal, Pavlina Tcherneva (2021)