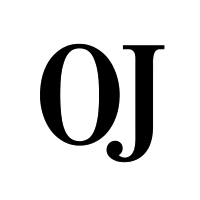La puissance selon Encel
Si l’on considère que la définition de la géopolitique est l’étude des rapports de force sur un territoire donné, alors la puissance est la clé de voûte de cette discipline. En effet, même si celle-ci a pu être contestée (”L’impuissance de la puissance” de Bertrand Badie), elle reste le premier cadre d’analyse dans cette discipline, […]

Si l’on considère que la définition de la géopolitique est l’étude des rapports de force sur un territoire donné, alors la puissance est la clé de voûte de cette discipline. En effet, même si celle-ci a pu être contestée (”L’impuissance de la puissance” de Bertrand Badie), elle reste le premier cadre d’analyse dans cette discipline, d’autant que cette perte d’importance de la puissance n’est relative qu’à sa définition.
Ainsi, en nous fournissant dans la première partie de son ouvrage “Les voies de la puissance” une sorte de manuel détaillé des éléments constituant la puissance d’un État, Frédéric Encel nous donne de nombreuses clés de lecture de la géopolitique.
Il choisit dans son livre de retenir que la puissance est la “capacité d’agir en souveraineté”, définition assez peu éloignée de celle de Serge Sur : “Capacité de faire, faire faire, refuser de faire et empêcher de faire”, que mes camarades de classe préparatoire connaissent bien. Il précise également que celle-ci, à l’instar de la technologie, souffre du problème de double usage, l’important n’étant pas la puissance mais la manière dont elle est utilisée.
J’ai fait le choix assumé de remanier les différents segments de la première partie de façon à la présenter de manière plus claire selon moi, mon résumé distingue donc ce qui sont pour moi des éléments « évidents » de la puissance et des éléments auxquels nous pensons moins souvent bien qu’aussi important dans l’analyse géopolitique. Je précise également que les références à d’autres auteurs sont de mon ressort et en aucun cas des liens faits par Frederic Encel.
I) Les éléments traditionnels de la puissance
Dans cet écrit, Encel nous présente plusieurs éléments que même le moins averti des observateurs aurait en tête. Il précise néanmoins sous quelle modalité ces éléments sont réellement constitutifs de la puissance.
La puissance militaire
Quand on pense à la puissance, on pense à l’armée, mais pour Frédéric Encel, certains aspects de cette force armée sont primordiaux. Tout d’abord, la qualité et la taille critique des effectifs sont extrêmement importantes. Encel entend par masse critique qu’une armée se doit d’avoir un nombre de soldats suffisamment important pour pouvoir exercer une réelle opposition en cas de conflit ; dans le cas contraire, la qualité ne pourra pas lui permettre de résister. De plus la construction d’une puissance supérieure par le biais de la force armée doit aujourd’hui passer par une capacité de projection permettant d’avoir un impact sur tous les enjeux, sujet d’autant plus important dans un monde mondialisé.
La démographie
Frédéric Encel décrit la démographie comme une arme à double tranchant ; en effet, le nombre joue autant que la composition de cette population. Différents critères comme l’âge, l’éducation, la docilité ou la répartition géographique font de cette population un atout pour la puissance de l’État ou non. Il est clair que les avantages et inconvénients de la démographie de la France et de la Tanzanie sont incomparables alors que ce sont deux populations de même taille.
L’économie
De manière analogue à la démographie, l’économie peut être considérée, selon Encel, comme ayant une double nature. Il est indéniable qu’une économie significative constitue un atout majeur. Cependant, toutes les structures économiques ne se valent pas ; leur utilité en termes de puissance dépend de leur composition. Une économie fondée sur la rente et l’exportation de matières premières peut sembler séduisante, mais elle nécessite une gestion judicieuse de cette ressource lucrative sous peine de subir le manque de résilience inhérent à ce modèle économique et des dépendances qu’il engendre par rapport des économies industrialisées à valeur ajoutée.
Diplomatie
Enfin, le dernier élément « évident » de la puissance des États réside dans la diplomatie. On pense immédiatement aux alliances dont Frédéric Encel recommande d’évaluer la fiabilité selon trois critères : la Capacité (à obtenir du soutien), l’Intérêt et la Sincérité. Le poids au sein des organisations internationales revêt également une importance considérable, bien qu’il soit essentiel de ne pas surestimer son impact (comme en témoigne le cas actuel de l’unilatéralisme d’Israël).
En outre, Encel souligne l’importance du corps diplomatique en tant qu’optimisateur d’une situation donnée ; une puissance doit savoir tirer parti au maximum de ses succès tout en limitant autant que possible ses revers. Pour ce faire, il est impératif pour un État de se doter d’un réseau de renseignement facilitant cette optimisation.
Soft Power
Frédéric Encel conteste l’idée selon laquelle le Soft Power pourrait remplacer le Hard Power ; pour lui, le premier constitue un excellent complément au second, comme l’a soutenu Hillary Clinton durant l’administration Obama. Il permet d’atténuer les effets négatifs du second, mais à lui seul, il ne peut pas constituer un véritable levier de pression.
Il avance également une condition essentielle à l’élaboration du Soft Power : celui-ci ne peut être construit par intérêt. En effet, il découle d’un modèle, d’une économie, d’une religion, etc., mais ne peut être imposé (comme en témoigne l’effondrement immédiat du Soft Power de l’URSS, trop axé sur la propagande, après 1991).
II) Des éléments de la puissance moins intuitifs
Ensuite, Frédéric Encel met en lumière des éléments de puissance plus discrets ou souvent négligés par le grand public. Bien qu’ils soient moins visibles, ces aspects sont néanmoins cruciaux pour comprendre les actions des différents États.
La Géographie
Bien que son rôle soit peut-être moins prépondérant qu’auparavant, la géographie demeure néanmoins aujourd’hui un facteur essentiel dans l’édification de la puissance, en permettant notamment la sanctification du territoire (une des clés de la puissance américaine selon Brzezinski dans Le Grand Échiquier) et en offrant des atouts naturels tels que les ressources. Il est extrêmement difficile de modifier la géographie d’un État ; ainsi, un pays aspirant à accroître sa puissance cherchera inévitablement à optimiser au maximum ses caractéristiques géographiques (comme l’illustre le cas de Kra en Thaïlande).
Le Psychologique
Cet aspect est relativement peu abordé lorsqu’il s’agit de considérer la puissance, pourtant la manière dont les dirigeants ou la population se perçoivent relativement aux autres acteurs affecte directement cette dernière. Une surestimation fondée sur des critères grotesques tels que l’ethnie ou la religion, par exemple, engendre des failles stratégiques coûteuses. À l’inverse, selon l’auteur, il est impératif de se concevoir comme une puissance pour réellement en devenir une.
La Cohésion Interne
Ce dernier élément, peut-être le plus important, est mis en avant par l’auteur dès le début de son ouvrage : il s’agit de la cohérence et de l’unité interne. En effet, il est impossible d’affronter des adversaires externes si la construction de la puissance est minée en interne. Plusieurs facteurs contribuent à cette cohésion, tels que le religieux (dernière utilité de ce domaine selon Y.N. Harari dans 21 Leçons pour le XXIème Siècle) ou le concept national qui nécessite l’établissement de symboles afin d’instaurer cette « volonté commune dans le présent » (Ernst Renan dans Qu’est-ce qu’une nation). Certains comme la rancœur sont à double tranchants car permettent l’unité à court terme mais mènent aussi à une fuite en avant desservant à terme la puissance comme la politique Nazie l’a montré.
Conclusion
En guise de brève conclusion, je ne peux que vous recommander de lire par vous-même, ou du moins d’appréhender au mieux cette première partie de « Les voies de la puissance » de Frédéric Encel à travers ce résumé. Si j’avais la possibilité de revenir en arrière, il est certain que j’aurais souhaité que mon professeur de spécialité géopolitique au lycée me propose ce livre comme première lecture dans ce domaine. Il est évident que ces points sont insuffisants pour saisir l’ensemble des enjeux géopolitiques mondiaux ; toutefois, si l’on s’en remet à la célèbre loi de Pareto, il me semble indéniable que cet ouvrage constitue les 20 % d’efforts nécessaires pour comprendre 80 % d’un sujet aussi complexe que la géopolitique.