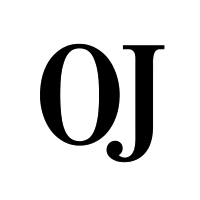L’histoire des banques : De la Mésopotamie aux enjeux contemporains
Introduction : Définir l’activité bancaire Nous gérons aujourd’hui nos finances au quotidien via des comptes bancaires, que ce soit pour nos économies ou pour des transactions simples. L’établissement bancaire moderne est devenu une commodité, bien plus pratique que de dissimuler son argent sous son matelas. Pour comprendre l’évolution de ce système, il est d’abord essentiel […]

Introduction : Définir l’activité bancaire
Nous gérons aujourd’hui nos finances au quotidien via des comptes bancaires, que ce soit pour nos économies ou pour des transactions simples. L’établissement bancaire moderne est devenu une commodité, bien plus pratique que de dissimuler son argent sous son matelas. Pour comprendre l’évolution de ce système, il est d’abord essentiel de définir ce qu’est une banque, car ses activités sont devenues extrêmement nombreuses et complexes.
Une banque est multiple : c’est un lieu physique (une agence) et un établissement. Ce sont des opérations (comme encaisser un chèque ou transférer de l’argent). C’est une activité (telle qu’accorder des crédits bancaires). Enfin, c’est une firme ou une marque qui perdure, à l’image du Crédit Agricole ou de la Banque de France.
Il est indéniable que l’activité bancaire découle naturellement des activités marchandes. Sans commerce, il n’y a pas de banque. L’histoire de la banque est donc intrinsèquement liée à l’histoire de l’économie, évoluant notamment avec la création de la monnaie.
Les fondations en Antiquité (3000 av. J.-C. – chute de Rome)
De l’échange primaire à la spécialisation
Avant même l’existence de l’écriture, les échanges se faisaient par le troc, impliquant l’échange direct de biens (par exemple, un poulet contre du poisson). Cependant, le troc devenait difficile pour les biens de grande valeur ou pour les objets encombrants à transporter. Des substituts furent donc adoptés, comme le blé, pour servir de monnaie étalon et simplifier l’évaluation des valeurs.
Lois et premières institutions
Vers 1750 avant notre ère, toujours en Mésopotamie (futur Irak), le célèbre Code d’Hammurabi fut érigé. Ce texte juridique ancestral contient des lignes régissant les prêts commerciaux, les taux d’intérêt, le dépôt de biens et les remboursements de dettes, des activités qui relèvent aujourd’hui de la banque. À cette époque, les prêtresses des temples géraient les biens, agissant comme des banquières. Le roi Hammurabi lui-même utilisait les temples comme réserves de richesse en leur demandant des « prêts sacrés » à faible taux d’intérêt.
L’invention de la monnaie frappée (vers le VIIe siècle avant notre ère), dont le poids et la valeur étaient garantis, facilita grandement les échanges. Toutefois, la monnaie restait souvent locale, nécessitant un service de change.
C’est en Égypte (au IIIe siècle avant notre ère) qu’apparaît la première trace écrite d’un mot désignant ce métier, évoquant principalement l’activité indispensable de change de monnaie. Une Banque Royale voit le jour, dont le siège était à Alexandrie. Elle gérait les affaires du roi sur tout le territoire, assurant l’encaissement et le paiement, y compris pour les particuliers.
En Grèce (IVe siècle), les Trapézites (échangeurs de haut niveau) officiaient sur la trapéza (la table de change). Ils réalisaient des opérations sophistiquées : ils pouvaient ouvrir des comptes, changer des monnaies et prêter de l’argent, y compris à des cités, parfois à des taux élevés allant de 12 à 20 %.
Sous l’Empire romain, l’activité bancaire fut largement assurée par des banquiers privés appelés negotiatores. Certains de ces banquiers suivaient les armées romaines dans leurs conquêtes, contribuant à la création rudimentaire d’un réseau international bancaire.
Néanmoins, il est crucial de noter que la banque durant l’Antiquité (même chez les Romains) était avant tout une banque de « dépôts », et ne servait pas encore massivement à l’épargne ou aux prêts pour les particuliers.
Le Moyen Âge et les innovations de la finance marchande
Difficultés et innovations du commerce
Après la chute de l’Empire romain, le commerce se maintint, mais l’activité bancaire eut du mal à s’établir dans une Europe morcelée. Cependant, au Proche-Orient et en Asie, les négociants-banquiers continuaient de prospérer.
Durant cette période, l’utilisation des lettres de change gagna en importance, notamment pour le commerce international. Ce mécanisme, ancêtre du chèque, permettait de ne pas transporter physiquement des sommes importantes. Le marchand se déplaçait avec une lettre (une reconnaissance de dette) qui autorisait un paiement auprès d’un banquier à l’arrivée. C’était une mesure de sécurité essentielle pour éviter les brigandages.
La morale chrétienne et l’émergence des spécialistes
L’avènement d’un christianisme rigoureux en Europe posa de sérieux problèmes à la finance. Il était considéré comme immoral de « jouer » avec l’argent et d’obtenir des intérêts sur un prêt. Le prêt à intérêt fut carrément interdit (bien que cette interdiction fût souvent contournée dans les faits).
Pendant un certain temps, les activités bancaires furent donc largement réservées aux étrangers qui n’étaient pas soumis à la morale ambiante, principalement les Juifs et les Italiens de Lombardie (les Lombards).
Les Lombards jouèrent un rôle crucial dans le développement bancaire européen. L’une des premières banques lombardes fut créée à Venise en 1151. Ils établirent ensuite leur réseau à travers l’Europe, donnant naissance à la célèbre rue des Lombards à Paris. Ce sont également ces Lombards qui mirent en place l’ancêtre du compte courant moderne.
Aux Xe et XIe siècles, l’expansion du commerce et des banques s’accéléra. Les chrétiens, notamment dans le contexte des croisades, cherchèrent à réintégrer ces activités. La lettre de change connut alors un essor fulgurant car elle permettait de contourner l’interdiction des prêts avec intérêt tout en sécurisant les transactions.
Finance et pouvoir royal
Durant cette époque, les hautes instances du pouvoir préféraient souvent s’appuyer sur des prêteurs privés. On pense notamment aux Templiers, extrêmement riches, qui finançaient l’État de Philippe le Bel. Le roi Charles VII s’appuyait quant à lui sur Jacques Cœur et son immense fortune. Cependant, cette position de puissance financière conférait un certain pouvoir aux financiers, ce qui déplaisait aux rois. Cette situation se termina souvent mal pour les banquiers : Philippe le Bel fit massacrer les Templiers, et Charles VII organisa un complot pour emprisonner Jacques Cœur, effaçant au passage les dettes de la couronne.
Partout en Europe, de puissantes familles créaient des banques, souvent pour accompagner les grandes familles royales dans la gestion de leurs royaumes. Les mœurs chrétiennes évoluèrent, permettant de nouveau la spéculation. Une hiérarchie s’établit dans les prêts : les Juifs prêtaient aux pauvres, les chrétiens à la bourgeoisie, et les banquiers florentins, comme les célèbres Médicis, aux puissants et très riches.
L’ère des grandes institutions et des banques centrales
La banque moderne naît à la Renaissance
C’est à la Renaissance que la banque se rapproche le plus de sa forme actuelle. Notamment dans le nord de l’Italie (Gênes), des banques comme la « fondation de la Casa di San Giorgio » furent établies. Ces institutions présentaient un double intérêt, agissant à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public : elles devaient faire prospérer les affaires régionales et financer les grands projets communautaires. Ce modèle se répandit progressivement en Europe.
Malgré ces avancées, la banque restait encore peu démocratisée, servant essentiellement les intérêts des marchands et des puissants.
Au XVIe siècle, la première bourse de cotation des matières premières fut créée à Anvers, posant les bases des marchés boursiers modernes.
La révolution de la banque centrale
La véritable transformation du monde bancaire survint avec la création de la Banque d’Amsterdam en 1609, la première banque centrale.
Une banque centrale remplissait les trois fonctions traditionnelles (stockage, échange et transfert des richesses) tout en y ajoutant une mission cruciale : établir des règles pour le pays. Elle avait une activité de régulation, non seulement se conformant à des règles, mais en imposant également aux autres. En structurant le marché national, elle contribua à bâtir le système bancaire européen, menant chaque pays à se doter de sa propre banque centrale. Ce cadre institutionnel était particulièrement pratique à une époque où l’expansion coloniale exigeait une coordination sans faille pour le commerce transcontinental.
À la fin du XVIIIe siècle, la banque était devenue une entreprise prospère et gargantuesque, investissant dans tous les domaines : assurances, armement, expéditions commerciales. De grandes familles dirigeaient encore ces établissements, préfigurant l’époque industrielle.
La Banque de France
En France, la Révolution de 1789 perturba les financiers, mais le coup d’État de Napoléon Ier marqua un renouveau. En 1800, Napoléon créa la Banque de France (notre banque centrale actuelle) avec les plus grands banquiers de l’époque. Cette institution était chargée de surveiller le système bancaire français et fut autorisée à émettre de la monnaie (des billets) pour approvisionner le marché.
Le début du XIXe siècle, malgré les guerres napoléoniennes coûteuses, fut témoin d’un essor spectaculaire des banques, parallèle à celui des industries. L’État y voyait un moyen efficace de remplir ses caisses, car beaucoup de ces banques étaient tenues par de très grandes familles industrielles et aristocrates, comme les Rothschild ou les Mallet, servant les intérêts de l’État.
Démocratisation, crises et régulation (XIXe et XXe Siècles)
L’universalisation des services
En 1818, sous Louis XVIII, la Caisse d’Épargne institua le livret d’épargne. Ce dispositif permettait à tous de placer une somme d’argent et de la faire fructifier. Bien que l’objectif initial fût de remplir les caisses de l’État, il offrait pour la première fois aux populations modestes la possibilité de mettre de l’argent de côté en prévision de coups durs. Le livret d’Épargne (qui deviendra plus tard le Livret A) devint l’un des produits bancaires les plus consommés de l’histoire, marquant le début de l’universalisation de la banque.
Au début de la IIIe République, on dénombrait en France pas moins de 2 000 petites agences bancaires locales, dépendant de la Banque de France et maillant le territoire.
Cependant, la banque française accusait un retard sur le modèle anglais, capable de centraliser à la fois les dépôts des particuliers et les investissements sur les gros marchés. Pour rivaliser, de grandes compagnies privées furent créées, comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Ces entreprises mirent en place de vastes réseaux d’agences et utilisèrent la publicité pour attirer la clientèle. C’est véritablement à cette époque que les particuliers commencèrent à souscrire massivement à des comptes bancaires en France. À titre d’exemple, le Crédit Lyonnais comptait 600 000 clients à la veille de la Première Guerre mondiale.
Crises et interventions étatiques
Le début du XXe siècle fut marqué par des turbulences. Suite à une crise bancaire en 1907 et au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, la population se rua sur les banques pour retirer ses fonds. Face au risque d’effondrement (les banques utilisant l’argent des dépôts pour entretenir l’économie), le gouvernement d’alors intervint en limitant les retraits. L’image des banques en fut fortement altérée.
La France se releva lentement dans les années 1920, finançant entreprises et industries. Mais en 1929 éclata la crise financière la plus grave de l’Histoire, aux États-Unis. La bourse de New York s’effondra suite à une spéculation massive, entraînant une « apocalypse financière » mondiale connue sous le nom de « Grande Dépression ».
Le résultat fut la fermeture de milliers de banques aux États-Unis et de plusieurs centaines en France, soit environ un quart des banques de l’époque. Certains économistes pensent même que cette crise a pu influencer l’arrivée d’Hitler au pouvoir en Allemagne.
Contrôle, nationalisation et libéralisation
Face à ces catastrophes, et suite à la Seconde Guerre mondiale, les États prirent la ferme décision de reprendre le contrôle de leur économie et de leurs banques. Aux États-Unis (dès 1933), le président Roosevelt sépara strictement les banques destinées aux grandes entreprises et celles dédiées aux particuliers (le Glass Steagall Act). La France appliqua des mesures similaires, allant jusqu’à nationaliser une partie des banques et imposer une réglementation stricte aux autres.
Deux facteurs clés permirent ensuite le développement massif du secteur en France : la création de la carte de crédit et l’obligation légale pour les employeurs de verser les salaires sur un compte bancaire. Par conséquent, la quasi-totalité des Français posséda un compte dans les années 1960/1970, et les dépôts bancaires furent multipliés par trois en dix ans.
Après une période de stabilité économique, le président Mitterrand nationalisa toutes les grandes banques françaises dans les années 1980 pour sécuriser leur gestion. Cependant, le libéralisme était à son apogée sur la scène internationale, conduisant à un relâchement des règles pour les marchés financiers. En France, une nouvelle loi bancaire fut adoptée en 1984, suivie en 1987 (sous le président Chirac) par la privatisation d’une grande partie des banques récemment nationalisées.
Conclusion
Aujourd’hui, la structuration des banques et de leurs activités est extrêmement complexe dans un marché de plus en plus globalisé. Un constat mitigé peut être fait : les banques sont parfois perçues négativement par le public en raison d’un manque de transparence et d’une trop grande cupidité ; une méfiance qui ne date pas d’hier (elle existait déjà au Moyen Âge).
Aussi, l’émergence des cryptomonnaies, en proposant une alternative décentralisée aux institutions bancaires traditionnelles, interroge à nouveau le rôle des banques dans un monde où la confiance pourrait, demain, se transférer du système bancaire aux algorithmes.