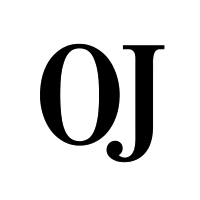Innover sans détricoter l’Etat social : quelles leçons tirer des thèses de Philippe Aghion pour la France ?
« Je crois qu’il faut une croissance parce qu’on ne peut pas distribuer ce qu’on ne produit pas. Mais je la veux inclusive. ». Cette phrase, prononcée par l’économiste français Philippe Aghion lors d’une audition au Conseil économique, social et environnemental (CESE), résume bien le dilemme auquel toutes les sociétés occidentales font face, la France […]
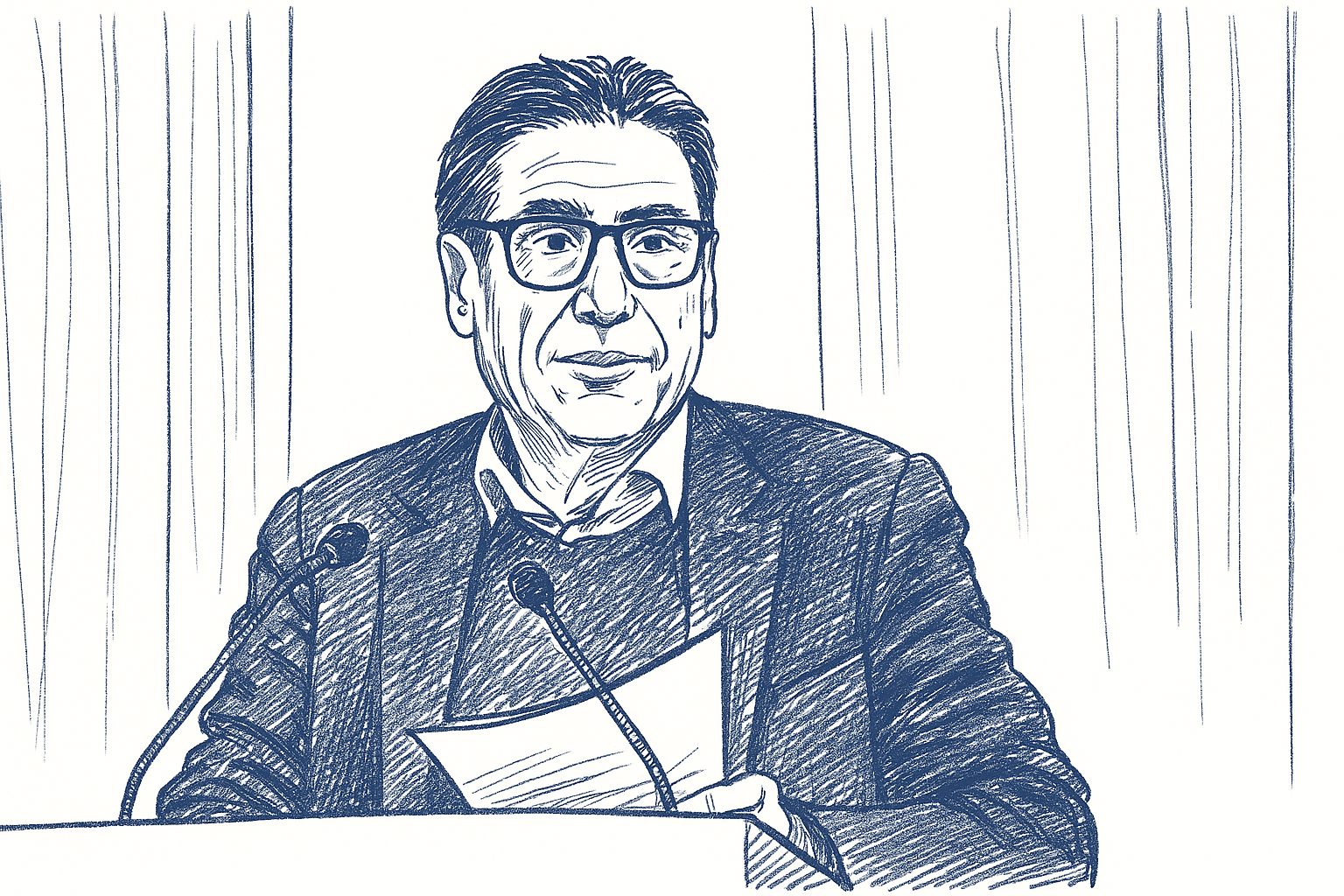
« Je crois qu’il faut une croissance parce qu’on ne peut pas distribuer ce qu’on ne produit pas. Mais je la veux inclusive. ». Cette phrase, prononcée par l’économiste français Philippe Aghion lors d’une audition au Conseil économique, social et environnemental (CESE), résume bien le dilemme auquel toutes les sociétés occidentales font face, la France tout particulièrement, en raison de son modèle social particulièrement développé : comment créer de la richesse tout en s’assurant qu’elle soit équitablement répartie, ou du moins la moins mal répartie possible ?
Aghion, dont l’expertise dans la science économique est reconnue par tous ses pairs et qui vient de lui valoir le Prix Nobel d’Économie cette année, est un économiste qui, s’il reconnaît bien sûr l’aspect technique et mathématique de l’analyse économique, demeure épris de justice sociale. Ainsi croit-il que la science économique, en cela qu’elle est une science sociale, a pour but d’achever la prospérité pour le plus grand nombre.
Professeur au Collège de France et à la London School of Economics, il a entre autres profondément renouvelé la manière de penser la croissance.
La croissance endogène : de la destruction à la création
En effet, ses travaux, menés avec le Canadien Peter Howitt à partir des années 1990, ont réaffirmé et démontré implacablement une idée ancienne et pourtant encore négligée : la croissance vient essentiellement de l’innovation, et cette innovation naît d’un mouvement permanent de destruction créatrice.
C’est ce processus, décrit dès 1942 par Joseph Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, qu’Aghion a su formaliser en modèle économique. Dans cette approche, la prospérité ne dépend plus d’une accumulation mécanique de capital ou de main-d’œuvre, mais de la capacité d’une société à inventer, à prendre des risques et à accepter le changement, notamment en l’accompagnant.
C’est la théorie de la croissance « endogène », par opposition au modèle exogène de Solow. Ici, le progrès technique ne tombe pas du ciel, mais est au contraire le produit des décisions d’entreprises et d’individus qui investissent dans la recherche et le développement, entretenant un cycle perpétuel, marqué de hauts et de bas, de bulles (cf. Internet en 90-2000, l’IA aujourd’hui) et de crises. Ces innovations font progresser la productivité, mais elles remplacent aussi les anciennes technologies, et forcent les entreprises et les travailleurs qui en dépendent à se mettre à la page.
Or, si la croissance repose majoritairement sur la destruction créatrice, alors toute société qui cherche à se protéger dudit changement finit, tôt ou tard, par s’appauvrir, laissée pour compte dans la mondialisation. C’est là que l’analyse d’Aghion devient particulièrement pertinente dans le cas français.
Une France bloquée entre peur du risque et excès de protection ?
Selon lui, la France ne manque ni d’ingénieurs, ni de chercheurs, ni de bonnes idées, mais elle manque de fluidité économique. Le pays protège ses structures existantes au lieu d’encourager l’expérimentation.
Les grandes entreprises bénéficient d’un environnement stable et de soutiens publics importants, tandis que les jeunes start-ups peinent à grandir. Et pour cause, le financement privé reste frileux, le capital-risque insuffisant, et la faillite, toujours perçue comme une honte. Le résultat, selon Aghion, est un système où l’innovation existe, mais la destruction créatrice est freinée.
De plus, l’économie française est pénalisée par son manque d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui sont le maillon manquant entre grandes entreprises d’un côté, et PME et TPE de l’autre.
Autrement dit, la France sait créer, mais n’ose pas détruire, et c’est ce blocage culturel et institutionnel qui bride sa croissance. Là où les États-Unis laissent une entreprise mourir pour qu’une autre prenne sa place, la France cherche à maintenir tout le monde en vie, souvent au prix d’une perte d’efficacité collective.
L’État français : de la nécessité de passer du colbertisme à l’État stratège
Il ne s’agit pas pour lui de prôner le retrait de la puissance publique, mais au contraire de repenser son action. La France, explique-t-il, reste prisonnière d’un réflexe colbertiste, hérité de la tradition planificatrice d’après-guerre. L’État choisit ses champions – hier le TGV ou Airbus, aujourd’hui l’hydrogène ou le nucléaire nouvelle génération – et leur consacre des milliards, au risque de verrouiller la concurrence.
Car Aghion estime que cette approche ne fonctionne plus dans une économie d’innovation rapide. L’État doit devenir stratège, non plus producteur direct de richesses, mais garant d’un environnement propice à la création : une éducation de qualité, des marchés ouverts, des institutions stables et une fiscalité claire et stable dans le temps. L’objectif n’est pas de remplacer le marché, mais de lui donner les moyens d’innover. Autrement dit, l’Etat doit assurer les services publics essentiels au bon fonctionnement de l’économie de marché, dans l’intérêt des travailleurs et de leur bien-être (qualifications, droits, qualité de vie) et des entreprises (infrastructures, cadre légal et fiscal, subventions ciblées).
Autre point crucial : la nécessité de l’évaluation des politiques publiques. En France, les politiques industrielles sont rarement mesurées à l’aune de leurs résultats, et quand bien même le seraient-elles, il est rare qu’on en tire réellement les conséquences. Chaque aide publique devrait être temporaire, transparente et conditionnée à l’efficacité, sous peine de devenir une rente et un effet d’aubaine. Il convient d’ajouter que cette observation pourrait être généralisée au-delà des simples politiques industrielles, car en cette période de diète budgétaire, l’évaluation de l’action publique semble devenir un levier essentiel de marges de manœuvre nouvelles.
Les freins culturels et institutionnels à la croissance
Au-delà des politiques économiques, Aghion met en cause un blocage culturel.
En France, l’échec entrepreneurial reste stigmatisé, les procédures administratives, souvent taxées de bureaucratiques, découragent la création d’entreprise et la mobilité professionnelle est faible.
Ces caractéristiques ne sont pas seulement économiques, mais sociologiques. Elles traduisent une peur collective de la désorganisation, un attachement au modèle du service public surprotecteur et du CDI à vie.
Pour Aghion, cette mentalité est incompatible avec le monde de la destruction créatrice, laquelle ne va qu’en s’accélérant.
L’innovation suppose de l’incertitude, et donc un filet de sécurité adapté : non pas des protections qui empêchent le changement, mais des protections qui permettent d’y survivre, en attendant les requalifications.
Il plaide ainsi pour une refonte de la protection sociale, fondée sur l’assurance plutôt que sur la rigidité, et sur la formation continue plutôt que sur la rente de situation : la fameuse « flexisécurité » qu’il répète à l’envi.
Le pari d’une croissance inclusive
Comme évoqué précédemment, l’un des aspects les plus singuliers de la pensée d’Aghion dans l’écosystème des économistes dits « néolibéraux » est sa volonté de réconcilier croissance et justice sociale.
Il considère que la destruction créatrice ne peut être politiquement et socialement viable que si elle s’accompagne de politiques d’accompagnement ambitieuses : formation, reconversion, mobilité, et soutien temporaire aux individus affectés par le changement
Cette vision d’une croissance inclusive se pose alors comme une alternative au pessimisme décroissant et au conservatisme bureaucratique, et comme un dépassement du modèle reagano-thatchérien classique, car il s’agit également d’établir une tentative de diagnostic sur les failles des tentatives de libéralisation des économies européennes et leurs dégâts sociaux.
Dès lors, la redistribution la plus efficace n’est pas celle qui compense les pertes, mais celle qui donne à chacun la possibilité de participer au marché du travail, à la création de valeur, et donc à la croissance. Éducation, innovation, recherche sont donc autant d’investissements publics qui produisent à la fois de la prospérité et de l’égalité des chances.
En somme, Aghion le dit bien : non, le modèle français n’est pas condamné à disparaître, mais il doit se réinventer, car il s’y trouve de nombreuses forces souvent trop peu exploitées, mais celles-ci ne pourront rester vraies qu’à la condition que l’on le transforme pour bâtir une société de progrès économique et social, pour réparer l’ascenseur social – et au passage, ravaler la façade.